Dans un monde de l’art toujours plus foisonnant, la critique reste une boussole précieuse. Mais à quoi sert-elle vraiment aujourd’hui ? Comment éclaire-t-elle le regard des publics et dialogue-t-elle avec l’histoire de l’art ? Fabien Simode, président de l’AICA-France, partage sa vision d’une discipline en pleine mutation, entre nouveaux enjeux, liberté de ton et reconnaissance d’un métier souvent méconnu.
Art 360 : En tant que président de l'AICA, comment voyez-vous évoluer aujourd'hui le rôle des critiques d'art dans l'écriture et la compréhension de l'histoire de l'art contemporain ?
Fabien Simode : C'est une excellente question, à laquelle nous consacrerons, le 11 septembre 2025 à l'Institut national de l'histoire de l'art, une "Rencontre aléatoire" (un format de discussion libre, ouvert aux membres de l'AICA-France et à toutes celles et ceux qui souhaitent débattre : historiens de l'art, commissaires d'expositions...) sur le thème : "Critiques ou historien.nes : qui écrit (vraiment) l'histoire de l'art ?".
Ce titre volontairement provocateur souligne que la situation de la critique d'art a changé depuis le début des années 2000. Elle n'a plus la même fonction qu'à la fin du XIXe siècle ou que dans les années 1960-1970, par exemple. Auparavant prescriptrice auprès, selon les époques, des collectionneurs, des galeries ou des musées, la critique d'art joue aujourd'hui davantage le rôle, il me semble, d'éclaireur.
Le critique d'art est désormais celui qui guide, qui accompagne un public de plus en plus large, fait de professionnels, d'amateurs éclairés et de simples curieux, dans un paysage parfois saturé d'offres artistiques. Il aide ce public à mieux comprendre et à mieux catégoriser les pratiques et les enjeux artistiques actuels.
Ceci est la conséquence, depuis les années 1980, de l'accroissement du nombre des artistes, comme de la multiplication des expositions, des lieux d'expositions (publics et privés) et des supports, qu'ils soient spécialisés (magazines, revues, maisons d'édition, sites Internet...) ou non - quel magazine généraliste ne consacre pas, aujourd'hui, une rubrique à l'art et aux expositions ! Sans parler, bien sûr, de la présence de l'art et des artistes sur les réseaux sociaux.
C'est ainsi que la critique d'art peut aider - doit aider ! - l'histoire de l'art à y voir plus clair, à décrypter et à hiérarchiser la multitude des propositions. On pourrait dire, pour simplifier à l'extrême, que la critique d'art d'aujourd'hui écrit l'histoire de l'art de demain...
D'autant plus que les ponts entre les deux disciplines sont jetés. Si l'on regarde les statistiques de l'AICA-France, il est frappant de constater qu'une grande partie des plus de 600 membres de l'association est issue d'une formation universitaire, notamment en histoire de l'art, et qu'un grand nombre de ces membres sont, parallèlement à leur activité de critique, doctorants ou professeurs à l'université, dans une école d'art, etc.
Critiques et historiens de l'art entretiennent des relations de bon voisinage. Ils s'invitent, échangent, débattent, tout en se jaugeant et en se jalousant parfois. Car, leurs approches diffèrent. Quand l'histoire adopte une approche scientifique et factuelle de l'art, la critique d'art a acquis, avec Diderot, une liberté de ton, d'écriture et d'approche, qui l'emmène du côté de la littérature, de la poésie, de la philosophie, du journalisme, etc.
Selon vous, existe-t-il des "mots réflexes" ou des expressions devenues incontournables dans la critique d'art actuelle, et qui marqueraient particulièrement notre époque ? Lesquels et pourquoi ?
A l'instar de la littérature, la critique d'art est un matériau vivant qui n'est ni hermétique ni insensible à son époque, à laquelle elle emprunte d'ailleurs ses mots et ses concepts. Voilà pourquoi un critique n'écrit plus aujourd'hui comme Félix Fénéon, Guillaume Apollinaire ou Yves Bonnefoy.
De là à dire qu'il y aurait des "mots réflexes" ou des "expressions incontournables", je ne le pense pas. Les diverses formes de la critique d'art (le journalisme, la poésie, le roman, l'essai, le podcast...) la protègent de la "formule", de la répétition et, donc, d'un certain ennui.
Toutefois, s'il n'y a pas de langage propre à la critique d'art, certains sujets sont devenus aujourd'hui incontournables, comme le post-colonialisme, l'environnement, l'étude des genres, des minorités dites visibles ou invisibles, etc. Autant de sujets de société questionnés par les artistes contemporains et par les historiens de l'art.
Pensez-vous que certains thèmes comme le genre, l'identité ou la question post-coloniale dominent trop fortement les débats actuels dans la critique d'art ? Comment rester ouvert à d'autres approches ?
Dire que les sujets identitaires ou post-coloniaux domineraient "trop fortement" la critique reviendrait à porter un jugement moral sur la pratique actuelle de la critique d'art, ce que je me refuse à faire !
Certes, ces sujets sont devenus très présents, mais ils sont nécessaires et témoignent des questions et des sensibilités qui traversent nos sociétés actuelles. Il faut s'en féliciter, tout en rappelant que la critique ne se réduit pas à ces seules thématiques.
Ces dernières cohabitent, en effet, avec des regards plus "classiques" portés sur la création visuelle : sur les techniques, sur les formes, sur la place des œuvres dans l'histoire de l'art, etc.
Quels sont aujourd'hui vos objectifs prioritaires pour le rayonnement de l'AICA, et comment comptez-vous les atteindre ?
Section française de l'Association internationale des critiques d'art, l'AICA-France poursuit plusieurs objectifs inscrits dans ses statuts : promouvoir la discipline dans le domaine de l’art, contribuer à en assurer les fondements méthodologiques, protéger les intérêts moraux et professionnels des critiques d’art et faire valoir les droits de tous ses membres.
A ce titre, nous travaillons avec l'AICA-International, le ministère de la Culture, le CIPAC (la Fédération des professionnels de l'art contemporain), l'Observatoire de la liberté de création (l'OLC, dont nous sommes membre fondateur), les Archives de la critique d'art (ACA), comme avec des musées, des centres d'art, des écoles d'art, des associations d'arts visuels, des fondations privées....
Notre objectif prioritaire est de porter la voix de la critique d'art auprès de tous les acteurs du monde de l'art et d'œuvrer à sa reconnaissance, par exemple sur la question de la rémunération ou de la liberté d'expression.
Un autre objectif important est d'opérer la liaison entre tous nos membres, en favorisant les rencontres nationales et internationales. Nous organisons ainsi, actuellement, le 13e Prix AICA-France Elisabeth Couturier de la critique d'art, qui se déroulera le 9 octobre 2025 à l'Institut national d'histoire de l'art, notre partenaire.
Outre réunir une dizaine de candidates et de candidats membres de l'AICA-France autour d'un jury de professionnels de l'art, cette soirée rassemble chaque année plus de 200 personnes dans l'auditorium de l'INHA.
Pour l'AICA-France, c'est l'un des temps forts de l'année, qui témoigne du dynamisme de la critique en France, et qui se traduit par la publication des interventions des candidates et des candidats au sein de la prestigieuse revue internationale Critique d'art, éditée par les ACA, avec lesquelles nous avons signé cette année un partenariat.
Dernier objectif : relayer ou participer à des appels à candidatures, des bourses d'écriture ou de résidence pour nos membres. L'AICA-France est ainsi partenaire de l'ADAGP et du Quotidien de l'art pour la bourse "Ekphrasis", de l'association devenir.art (réseau des arts visuels en Centre-Val de Loire) pour la bourse "Chroniques"...
Pour cet automne, nous mettons également en place une résidence croisée avec l'AICA-UK, afin d'accueillir à Paris un critique d'art britannique (avec le soutien de la Fondation des artistes/Maba) et de faire voyager à Londres un critique d'art français. Nos actions sont diverses et nombreuses.
À votre avis, quels sont les grands défis auxquels la critique d'art devra faire face dans les années à venir, et comment l'AICA compte-t-elle y répondre ?
La critique d'art doit relever, à mon sens, deux défis majeurs. Le premier concerne les nouveaux outils de diffusion : la critique ne se cantonne plus à la seule littérature sur l'art, dans la presse ou l'édition spécialisée ; elle doit s'adapter aux réseaux sociaux, aux podcasts, à la vidéo, aux nouvelles formes de documentaires, comme à certaines formes artistiques qui intègrent désormais la critique. Cela peut paraître simple, mais cela pose la question de la définition de la critique d'art, de ses frontières et du rôle qu'elle joue désormais.
Le deuxième enjeu est plus technique : il s'agit des conditions de travail et de rémunération des critiques d'art. La critique d'art a longtemps été perçue comme une activité annexe, un hobby pas toujours rémunéré à la hauteur de son engagement... Depuis plusieurs années, l'AICA-France défend des recommandations tarifaires qu'elle s'applique à promouvoir auprès des commanditaires et des acteurs de l'art, ainsi que le statut d'auteurs.autrices historiquement précaire. Certes, les mentalités évoluent dans le bon sens, mais il reste du boulot à faire, notamment dans un contexte budgétaire qui aggrave la précarité du secteur culturel.
Pourriez-vous nous définir ce qu'est la critique d'art, son rôle, sa spécificité, son utilité, ce qui en fait une forme particulière d'écriture ?
Vaste question ! Les frontières de la critique d’art n'ont cessé d'évoluer depuis le XVIIIe siècle. Dans l'article qu'il consacre à la critique d'art (dans Grove (Oxford) Dictionary of Art), l'historien et critique américain James Elkins admet que cette activité "n'a pas de définition formelle ni de sens universellement reconnu". C'est ainsi que la France accepte le commissariat d'expositions au sein de la critique d'art, par exemple, quand nombre de pays s'y refusent catégoriquement !
Ainsi, comment définir une discipline qui se situe aux confins de la poésie, de la philosophie et du journalisme ? Nous pouvons tout de même dire, sans trop nous tromper, que la critique d'art englobe toute forme de discours qui porte sur la création artistique, qu'il soit écrit, oral, filmique ou scénique.
Ce n'est pas parce qu'un discours aborde la création artistique qu'il appartient de facto à la critique d'art. Il doit pour cela porter un jugement, un regard à la fois analytique et subjectif. La critique d'art cherche à évaluer une œuvre, à l'interpréter et à la situer dans son contexte esthétique, culturel et social.
Située à la croisée de l’expérience sensible et de la réflexion intellectuelle, elle peut être par conséquent élogieuse ou sévère, descriptive ou interprétative, technique ou littéraire... En cela, la critique d'art joue un rôle essentiel dans la réception des œuvres et dans la construction de leur valeur historique et symbolique.

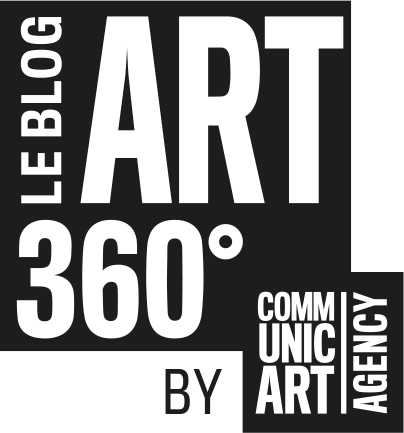




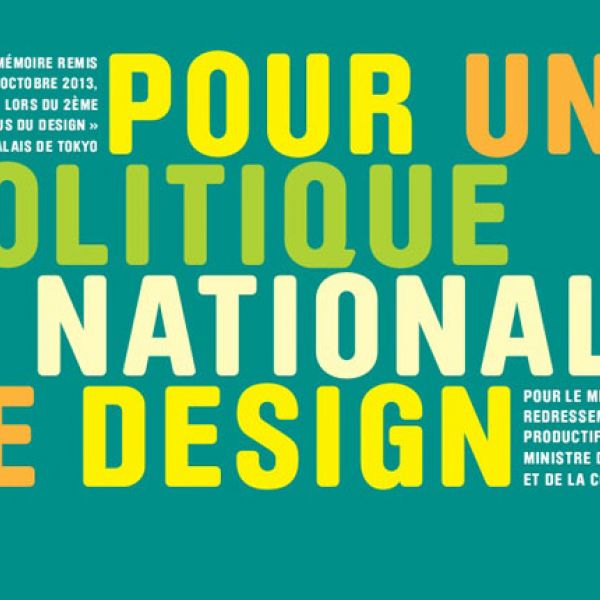
 Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »
Restitution des œuvres d’art : « Il est urgent de réinventer une nouvelle forme de gouvernance culturelle »
 "Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"
"Bien communiquer est un art à forte valeur ajoutée"